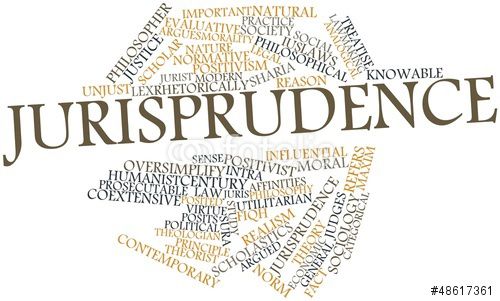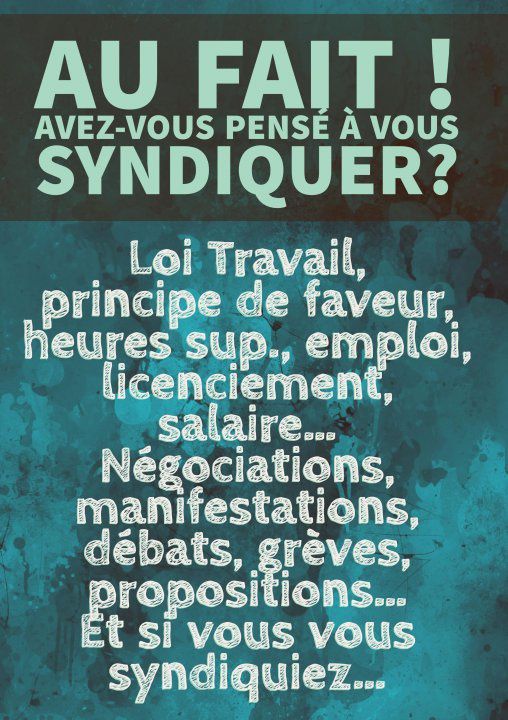CEDH / Code du travail / Droits fondamentaux / Harcèlement / Licenciement / NTIC / CPH / IRP / Syndicat
VOS DROITS

La preuve du salarié devant le juge prud’homal
- Saisir le juge prud’homal c’est se confronter à l’épineuse question de l’administration de la preuve. Le succès de l’action en justice en dépend. Il faudra, par le biais du dossier présenté, réussir à emporter la conviction du juge concernant l’existence de son droit ou la réalité de sa prétention.
Le droit de la preuve est inhérent à l’égalité des armes garantie par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, 27/10/1993, Dombo c./ Pays Bas).
Or, dans la pratique, il est beaucoup plus aisé pour l’employeur, propriétaire de l’entreprise et des documents s’y trouvant, d’apporter, devant le juge, la preuve de ses allégations, que pour le salarié.
C’est la raison pour laquelle, la preuve devant les juridictions du travail jouit de spécificités visant à compenser cette inégalité des armes entre les plaideurs face à la preuve.
- Cette spécificité concerne les deux facettes de la preuve.
La première facette traite de la charge de la preuve. Celle-ci consiste à se demander sur qui pèse la lourde tâche de prouver l’existence de son droit ou de la réalité de sa prétention.
La seconde facette concerne le mode de preuve. Celle-ci vise à s’interroger sur les moyens permettant de prouver son droit ou sa prétention.

I. LA CHARGE DE LA PREUVE PESANT SUR LE SALARIE
Le droit commun de la preuve est régi par le principe suivant lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver (…) (art.1353 du code civil). En principe, la charge de la preuve incombe donc au demandeur, à savoir le salarié (les contentieux étant pour la plupart diligentés par celui-ci).
Il existe, fort heureusement, des règles spécifiques aux fins de rééquilibrer les rapports inégalitaires existants entre le salarié et son employeur. On parle alors d’aménagement voire d’inversion de la charge de la preuve.
- Deux logiques sont poursuivies.
La première logique consiste à aménager la charge de la preuve eu égard aux obligations administratives pesant sur l’employeur. Si pèse sur l’employeur l’obligation d’établir certains documents, il apparaît logique qu’il soit en charge de les produire devant le juge.
La seconde logique vise à protéger le salarié, soit parce qu’est en jeu un droit fondamental, soit parce qu’on est en présence du pouvoir suprême de l’employeur : celui de sanctionner, voire de licencier.

A. Un aménagement justifié par les obligations pesant sur l’employeur
L’aménagement de la charge de la preuve est parfois justifié eu égard aux obligations pesant sur l’employeur. Tel est, par exemple, le cas en matière de contentieux relatif aux heures effectuées, à la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet ou dans certaines affaires visant à obtenir des dommages et intérêt en réparation du préjudice subi.
1. La preuve des heures effectuées
Le litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées (notamment l’accomplissement d’heures supplémentaires) jouit de particularités. Ces particularités s’expliquent au vu de l’obligation qui pèse sur l’employeur de décompter les heures travaillées par ses salariés (art. L 3171-3 du code du travail).
Il ressort de l’article L 3171-4 du code du travail que :
"L’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles."

Ainsi, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties (Cass. soc., 3-7-96, n°93-41645). La charge de la preuve est donc partagée.
En pratique, le salarié n’a pas à fournir la preuve des heures travaillées. Le juge ne peut donc rejeter une demande en paiement d’heures supplémentaires au seul motif de l’insuffisance des preuves apportées par le salarié. Il doit examiner les éléments que l’employeur est tenu de lui fournir (Cass. soc., 3-7-96, n°93-41645).
Pour autant, le salarié n’est pas totalement exonéré de la charge de la preuve. L’intéressé doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Cass. soc., 25-2-04, n°01-45441).
Il ne peut se contenter de présenter de simples allégations. Il doit fournir au juge un début de commencement de preuve. Par exemple, une fiche de temps remplie de sa main, des captures écran, des attestations de témoignage, etc.

A noter que, lorsqu’est en cause le respect des durées maximales de travail ou le respect des durées minimales de repos, la charge de la preuve n’est pas partagée entre les parties.
Elle incombe exclusivement à l’employeur (Cass. soc., 20-2-13, n° 11-28811 ; Cass. soc., 8-4-15, n° 13-24873).
2. La preuve du travail à temps partiel
Lorsqu’un employeur souhaite faire travailler un salarié à temps partiel, il a l’obligation de formaliser cette relation de travail par un contrat (ou un avenant) faisant figurer certaines mentions, notamment la durée du travail (art. L 3123-6 et L 3123-27 du code du travail).
Le manquement à cette obligation fait présumer que le contrat est à temps plein.
Il s’agit d’une présomption simple. L’employeur a alors l’obligation de démontrer que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de son employeur (Cass. soc., 19-6-90, n°86-44330 ; Cass. soc., 15-3-06, n° 03-47181).
3. Les présomptions de préjudice [1]
En droit de la responsabilité civile classique, l’octroi de dommages et intérêts impose aux salariés de démontrer le dommage, le préjudice ainsi que le lien de causalité (art. 1240 du code civil).
Dans certains domaines, la Cour de cassation admet que le manquement de l’employeur puisse nécessairement causer un préjudice au salarié.
Le simple constat d’un manquement de l’employeur à ses obligations suffit à engager sa responsabilité. Le préjudice du salarié découle ainsi de la faute patronale. Il y a donc une présomption du dommage. La charge de la preuve du salarié s’en trouve allégée puisqu’il suffit d’apporter la preuve du dommage.
A ce titre, certains auteurs ont parlé de préjudice nécessaire, de présomption de préjudice, ou de préjudice automatique.
La jurisprudence a eu recours aux présomptions de préjudices dans des domaines divers et variés.
A titre d’illustrations, dans le domaine des obligations administratives de l’employeur, constituent un préjudice nécessaire : la délivrance tardive du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi (Cass. soc., 5-7-11, n°10-30465), du bulletin de paie (Cass. soc.,15-12-10, n°08-4516) mais également le défaut d’indication de la convention collective sur le bulletin de paie (Cass. soc., 19-4-04, n°02-44671).
Concernant l’obligation pour l’employeur de préserver la santé des travailleurs, le juge a reconnu, notamment, un préjudice automatique concernant la privation du repos quotidien (Cass. soc., 8-6-11, n°09-67051) ou le défaut de visite médicale d’embauche (Cass. soc., 17-10-12, n°10-12852).
Pour autant, une jurisprudence récente a mis à mal le concept de préjudice automatique, bien que des incertitudes demeurent quant au revirement de jurisprudence opéré (Cass. soc., 13-4,16, n°14-28293).
Malheureusement pour les salariés, la mise à mort des présomptions de préjudices est à craindre eu égard aux termes généraux de l’arrêt et au fait qu’il soit publié au rapport annuel de la Cour de cassation.
B. Un aménagement justifié par l’atteinte à un droit fondamental
Afin de protéger la partie la plus faible, la loi a procédé à un aménagement de la charge de la preuve lorsqu’est en cause un droit fondamental. Tel est le cas des contentieux visant à prouver une discrimination ou un harcèlement.
1. La preuve d’une discrimination
La charge de la preuve est répartie entre les deux parties en cause.
Cet aménagement de la charge de la preuve a été amorcé par la jurisprudence (Cass. soc., 23-11-99, n°97-42940), inspirée par le droit communautaire [2]. La loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 a unifié le régime de la preuve des discriminations en modifiant l’article L 1134-1 du code du travail relatif au régime de la preuve des discriminations et l’article L 1144-1 relatif à la preuve des discriminations fondées sur le sexe.
Toute personne qui allègue d’une discrimination directe ou indirecte doit présenter devant le juge des faits qui permettent d’en présumer l’existence. En d’autres termes, il appartient au salarié ou au candidat d’apporter des éléments qui, au moins en apparence, peuvent laisser croire à une discrimination.
Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (art. L 1134-1 et L 1144-1 du code du travail).
Par exemple, un salarié syndiqué établira qu’il est le seul salarié de son entreprise employant 20 salariés à ne pas avoir bénéficié d’une promotion en 15 ans. Cette allégation, bien que non rattachée par le salarié à son appartenance syndicale, apparaîtra suspecte. L’employeur devra alors démontrer que le traitement n’est pas discriminatoire, en rapportant la preuve que des motifs étrangers à l’appartenance syndicale justifient la différence litigieuse.
Un seul fait suffit (Cass. soc., 6-11-13, n°12-22270) et la comparaison avec d’autres salariés n’est pas indispensable (Cass. soc., 10-11-09, n°07-42849).
En matière d’égalité de traitement, la jurisprudence a procédé à un rapprochement du régime probatoire existant en matière de discrimination.

Le salarié qui invoque une rupture d’égalité de traitement doit présenter au juge des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement.
Charge, par la suite, pour l’employeur de démontrer que cette différence de traitement est basée sur des éléments objectifs et pertinents (Cass. soc., 25-5-05, n°04-40169 ; Cass. soc., 20-10-10, n°08-19-748).
Les juges du fond auront alors la lourde tâche de contrôler la réalité et la pertinence des raisons objectives avancées par l’employeur (Cass. soc., 15-5-07, n°05-43292).
Le principe d’égalité de traitement est applicable aux conventions collectives. Cela signifie que les avantages issus des conventions collectives peuvent être modulés voire réservés à certaines catégories professionnelles sous réserve que cette différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes tenant à la spécificité de la situation des salariés auxquels l’avantage est accordé (Cass. soc., 8-6-11, n°10-11933).
Pour autant, concernant ces avantages conventionnels, il existe malheureusement un mode de preuve particulier (Cass. soc., 27-1-15, n°13-22179) [3]. Désormais, les différences de traitement entre catégories professionnelles prévues par accord sont présumées justifiées. Dès lors, il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Cette présomption de conformité, est incontestablement l’une des conséquences de la loi de 2008 qui a instauré un nouveau système de légitimité des syndicats reposant sur le vote des électeurs. Il n’est pas impossible que, dans les prochaines semaines, le gouvernement tente de la généraliser, à l’occasion de la réforme du droit du travail qu’il entend mettre en œuvre par voie d’ordonnances…
2. La preuve du harcèlement
Il existe un aménagement de la charge de la preuve en matière de harcèlement. Cette spécificité se justifie par le fait que les situations de harcèlement moral s’accompagnent d’un grand isolement et de difficultés pour le salarié de prendre conscience de ce qui lui arrive.
Les règles en la matière ont connu des soubresauts.
Tout a commencé avec la loi n°2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002. Celle-ci a aménagé la charge de la preuve en faveur de la victime de harcèlement.
En cas de litige, le salarié (ou candidat) devait uniquement présenter les éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombait à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge devait former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Dans un second temps, la loi du 3 janvier 2003 a procédé à un rééquilibrage de la charge de la preuve, au détriment du salarié, en imposant à la victime d’un harcèlement d’établir des faits (et non plus seulement de présenter des éléments de fait) qui permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement.
Puis la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est revenue au positionnement de la loi de 2002, en considérant que la victime de harcèlement doit uniquement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement (art. L 1154-1 du code du travail).

C. Un aménagement instauré dans une logique de protection face au pouvoir de licenciement et de sanction de l’employeur
La preuve de la cause réelle et sérieuse et de la sanction disciplinaire est partagée. En revanche, le risque pèse sur l’employeur.
1. La preuve de la cause réelle et sérieuse
Aucune des parties ne supporte la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement. Toutes deux devront apporter des éléments au soutien de leurs allégations (art. L 1335-1 du code du travail ; Cass. soc., 11-12-1997, n°96-42045).
La mission à la charge de l’employeur consiste à démontrer la véracité des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, dans la mesure où celle-ci fixe les limites du litige (Cass. soc., 19-6-91, n°89-40843 ; Cass. soc., 14-10-93, n°92-42227). L’employeur ne peut donc plus invoquer devant le juge des motifs de licenciement non-inscrits dans la lettre.
Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (art. L 1235-1 du code du travail). Le juge dispose d’une double mission. Il ne doit pas seulement vérifier si le motif allégué par l’employeur est réel et sérieux ; il doit également rechercher s’il n’existe pas un autre motif et si celui-ci n’est pas le véritable motif de licenciement (Cass. soc., 26-5-08, n°96-41062).
Pour autant, l’employeur a un travail supplémentaire à fournir, en matière de preuve. En effet, dans l’hypothèse où le juge n’arrive pas à former sa conviction concernant l’existence ou l’absence d’une cause réelle et sérieuse du licenciement, le doute profite au salarié (art. L 1235-1 du code du travail). Le juge accorde ainsi le bénéfice au salarié, en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 6-12-00, n° 98-46041).
2. La preuve de la faute disciplinaire
En cas de contentieux relatif à l’existence de la faute disciplinaire, la charge de la preuve est également partagée.
En effet, l’article L 1333-1 du code du travail fait obligation à l’employeur, auteur de la sanction, de fournir au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction et, au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour autant, encore une fois, l’employeur a plutôt intérêt à être minutieux, dans la mesure où le risque de la preuve pèse sur lui. En effet, si un doute subsiste, il profite au salarié (art. L 1333-1 du code du travail).
Au vu des éléments produits par les parties, le juge pourra minorer la faute retenue (ex. un licenciement pour faute grave sera requalifié en licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, voire en licenciement sans cause réelle et sérieuse). En revanche, l’inverse n’est pas vrai. Le juge ne pourra jamais majorer la gravité de la faute commise par le salarié.
Le contentieux de la faute grave jouit d’une exception à cette règle. La charge de la preuve pèse alors en totalité sur l’employeur (Cass. soc., 20-7-89, n°87-41425 ; Cass. soc., 22-2-96, n°92-43353).
Une telle spécificité s’explique par le fait qu’en licenciant un salarié pour faute grave, l’employeur s’auto-libère de son obligation de verser au salarié l’indemnité de licenciement et le préavis. Or, il ressort de l’article 1353 du code civil que : celui qui se prétend libéré [d’une obligation] doit justifier […] le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le fait que la charge de la preuve pèse sur l’employeur peut être utilisé à l’appui d’une demande formulée devant le BCO visant à ordonner à l’employeur de produire en premier ses éléments de preuve sur la gravité de la faute, ce qui aurait pour conséquence d’inverser le calendrier de communication de pièces [4].

II. LES MODES DE PREUVE A DISPOSITION DU SALARIE
La preuve en droit du travail est libre (Cass. soc., 27-3-07, n°98-44666). Cette liberté dans l’administration de la preuve connaît des limites.
Lorsque ces limites sont franchies, la preuve est jugée irrecevable par le juge. En d’autres termes, celle-ci est rejetée.
Ces limites sont fréquemment débattues dans les prétoires et suscitent de multitudes interrogations :
est-il possible de se constituer une preuve à soi-même ?
Peut-on soustraire des documents appartenant à l’entreprise pour assurer sa défense ?
Peut-on produire des procédés issus des nouvelles technologie de l’information et de la communication (NTIC) ?
Peut-on demander l’aide de tiers pour constituer cette preuve ?

A. L’interdiction de se constituer une preuve à soi-même ?
- Il existe un adage suivant lequel : nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
Cet argument est souvent soulevé par l’employeur afin de faire rejeter une pièce, notamment des certificats médicaux gênants ou des relevés d’heures établis de la main du salarié.
Face à une telle allégation, il convient de rappeler à la partie adverse que ce principe ne peut être opposé exclusivement concernant les actes juridiques et non les faits juridiques (Cass. 2e civ, 6-3-14, n°13-14295 ; Cass. 1re civ., 13-2-07, n°05-12016).
Il est évident qu’un élément produit de manière unilatérale n’aura pas la même force probante qu’un élément objectif, mais il appartient alors au juge d’en apprécier souverainement la force de conviction.
1. La production de certificats médicaux
La force probante des certificats médicaux produits par le salarié, notamment dans le cadre d’un contentieux en harcèlement moral est fréquemment débattue. Se pose alors la question de savoir si un certificat médical faisant mention d’un état dépressif est susceptible de constituer un élément de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ?
La production de certificats médicaux est admise (Cass. soc., 30-4-09, n°07-43219). Si ce type de document peut faire partie du faisceau d’indices du juge, il ne pourrait, à lui seul, suffire. Ainsi, lorsque le salarié ne verse aux débats que des certificats médicaux pour établir l’existence d’un harcèlement moral, celui-ci ne pourrait être caractérisé (Cass. soc., 29-1-13, n°11-22174). En effet, si un certificat médical démontre la dégradation de l’état de santé du salarié, il est insuffisant à prouver le lien de cette dégradation avec le travail.
2. Les relevés d’heures établis par le salarié
Comme nous l’avons vu, en matière de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Cass. soc., 25-2-04, n°01-45441).
A été admis, comme éléments de nature à étayer la demande du salarié, un simple relevé manuscrit de l’intéressé de ses heures de travail (Cass. soc., 24-11-10, n°09-40928), des fiches de temps qu’il était tenu d’établir (Cass. soc., 25-4-01, n° 99-43056). A charge pour l’employeur d’apporter des éléments contraires.
B. Les documents appartenant à l’entreprise
Cela renvoie à une multitude de situations : le fait de s’accaparer des documents appartenant à son employeur, mais également le fait de les photocopier ou de procéder à leur transfert dématérialisé sur un ordinateur ou une clé USB.
Trois questions se posent alors.
Y a t-il vol ?
Le salarié commet-il une faute disciplinaire ?
Un tel document est-il recevable devant le juge ?
Cette question de la recevabilité d’un tel mode de preuve renvoie à l’article 9 du code de procédure civile qui fait obligation aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Une preuve ne peut donc être illicite.
La jurisprudence a tenté, autant que faire ce peu, de concilier deux droits fondamentaux :
- le droit de propriété et le droit de la défense.
La Chambre criminelle (Cass. crim., 11-5-04, n°03-80254) a considéré que soustraire un document de l’entreprise par photocopie, sans autorisation de l’employeur, afin de le produire au cours d’une instance prud’homale n’est pas constitutif d’un vol, à partir du moment où, d’une part, le salarié avait pris connaissance dudit document dans l’exercice de ses fonctions et, d’autre part, que celui-ci était strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense.
La Chambre sociale s’est alignée sur cette jurisprudence pour considérer qu’un document appartenant à l’entreprise est recevable si les deux mêmes conditions sont remplies (Cass. soc., 30-6-04, n°02-41720). Dans cette affaire, la Cour de cassation a considéré que le licenciement du salarié pour manquement à son obligation de discrétion absolue et de secret professionnel et vol de document ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle de licenciement.
Revenons sur ces conditions.
La première condition est que le salarié ait pris connaissance du document dans l’exercice de ses fonctions. En clair, le salarié ne doit pas avoir fouillé dans le bureau de ses collègues ou de son supérieur pour avoir connaissance du document. Cette condition peut être contestée, dans la mesure où elle est susceptible de porter atteinte à l’égalité des armes entre les salariés. Il sera, en effet, beaucoup plus aisé pour les salariés ayant des responsabilités de remplir cette condition. Certains auteurs ont même parlé de jurisprudence discriminante, selon la place du salarié dans l’entreprise [5].
La deuxième condition est que le document soit strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense. Ainsi, non seulement il faut que le document soit en rapport avec l’affaire prud’homale mais, en plus, il est nécessaire que celui-ci constitue l’unique moyen pour faire respecter ses droits. Le juge va notamment s’intéresser, dans le cadre de son contrôle, à la chronologie des faits c’est-à-dire au temps espaçant l’évènement générateur du conflit (ou la saisine du conseil) de la soustraction du document (Cass. crim., 16-6-11, n°10-85079).
De la même manière, l’employeur ne peut arguer que le document produit en justice est couvert par le secret professionnel pour contester sa recevabilité devant le juge, si celui-ci est strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense (Cass. soc., 5-7-11, n°09-42959 ;Cass. soc., 18-77-09, n°08-42498).
Récemment une autre question s’est posée en jurisprudence : Un syndicat peut-il produire en justice des documents de l’entreprise que les délégués du personnel ont pu consulter dans le cadre de leur mission, lesquels contenant, pour certains, des données personnelles ? (Cass. soc., 9-11-16, n°15-10203).
En l’espèce, il s’agissait d’un contentieux diligenté par un syndicat pour non-respect du repos dominical. Pour prouver cette irrégularité, le syndicat produit des décomptes du temps de travail hebdomadaire des salariés, des plannings, des contrats de travail à temps partiel mentionnant les horaires de travail effectués le dimanche et les bulletins de paie. Ces documents avaient été consultés par les DP en vertu de l’article L.3171-2, lesquels les avaient photocopiés en vue de les produire en justice.
Le juge du fond juge le procédé de preuve illicite arguant, d’une part, que les documents produits appartiennent à la société et, d’autre part, que la consultation des DP autorisée par l’article L 3171-2 exclut toute possibilité de photographie et encore moins de production en justice ; enfin qu’il n’est pas justifié que les salariés aient donné leur accord à la production des documents les concernant.
- La Cour de cassation a cassé un tel raisonnement.
La Cour énonce que :
L’article L 3171-2 du code du travail, qui autorise les délégués du personnel à consulter les documents (…) n’interdit pas à un syndicat de produire ces documents en justice.
Pour les documents comprenant des données à caractère personnelle, la Cour considère que :
Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
C. Les moyens de preuve issus des NTIC
Depuis quelques années, les NTIC sont de plus en plus utilisées dans les prétoires : enregistrement de conversations téléphoniques ou d’images, SMS, mails. De telles preuves sont admises, sous la limite de ne pas être obtenues de manière déloyale.
1. L’enregistrement de conversations téléphoniques et d’images
L’enregistrement d’une conversation téléphonique ou de l’image à l’insu d’une personne constitue un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue (Cass. 2e civ.,7-10-04, n°03-12653 ; Cass. soc., 29-1-08, n°06-45814).
Se pose alors la question de savoir s’il est possible de contourner cette difficulté en procédant, non pas par enregistrement, mais par témoignage d’un tiers ayant entendu la conversation par l’intermédiaire du haut-parleur du téléphone, sans que celui à qui l’on opposerait ce témoignage n’ait été informé de la présence de ce tiers écoutant. Ce mode de preuve a également été jugé déloyal par la Chambre sociale (Cass. soc., 16-12-08, n°07-43993).
Toutefois, la jurisprudence n’est pas la même lorsque l’émetteur avait conscience d’être enregistré. Tel est le cas, lorsque l’intéressé laisse un message sur le répondeur du téléphone (Cass. soc., 6-2-13, n°11-23738).
2. Les SMS
La Cour de cassation a jugé que les SMS pouvaient également être produits devant le juge dans la mesure où L’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur (Cass. soc., 23-5-07, n°06-43209).

3. Les courriels
Les courriels sont de plus en plus produits devant le conseil de prud’hommes.
Un courrier électronique peut être retenu comme moyen de preuve dans une procédure prud’homale, dès lors qu’il s’agit de prouver l’existence d’un fait (Cass. soc., 25-9-13, n°11-25884).
Il appartient au juge du fond d’apprécier la fiabilité des courriels. En effet, un mail peut assez aisément été modifié, créé de toutes pièces et même anti daté. Celui-ci, par ailleurs, ne fait pas nécessairement figurer la signature de son auteur.
Si le salarié est bien le destinataire du mail, l’employeur ne saurait se cacher derrière une prétendue violation du secret des correspondances. En effet, un tel manquement nécessite que le destinataire du courriel soit une tierce personne (art. 226-15 du code pénal).

D. Le recours aux tiers
Le salarié peut recourir à des tiers pour l’aider à prouver le caractère bien-fondé de sa demande devant le juge. Il peut s’agir de témoins, de l’inspection du travail, voire du juge, par le biais d’outils procéduraux.
1. Le recours aux témoins
Il est possible devant le juge de recourir à des attestations de témoignage.
Un formalisme est prescrit (art. 202 du code de procédure civile). D’une part, l’attestation de témoignage doit être écrite de manière manuscrite et comprendre un certain nombre de mentions (à noter qu’un formulaire cerfa N° 11527*02 se trouve aisément sur internet).
D’autre part, l’attestation doit être accompagnée d’un document établissant l’identité du signataire.
Les avocats des employeurs se cachent fréquemment sur le non-respect des règles de forme, pour tenter de faire rejeter ces attestations. Or, ces règles ne sont pas prescrites à peine de nullité (Cass. 2e civ., 21-2-08, n°08-60022). Ainsi, il appartient au juge du fond d’en apprécier la valeur probante. S’il entend écarter une attestation, le juge doit préciser en quoi celle-ci n’est pas régulière (Cass. soc., 9-10-96, n°93-45604).
Quant au contenu des attestations, celles-ci doivent relater des faits dont l’auteur a eu directement connaissance. Afin d’être dotés d’une véritable valeur probante, les faits relatés doivent être suffisamment précis (notamment quant aux dates) et ne peuvent se contenter de relayer les propos du salarié, demandeur au litige.
Un salarié ne peut être ni sanctionné ni licencié pour avoir témoigné en faveur d’un salarié. Une telle mesure serait jugée nulle, en raison de l’atteinte portée à la liberté fondamentale de témoigner, sauf en cas de mauvaise foi son auteur (Cass. soc., 29-10-13, no12-22447).
Une attestation de témoignage du conseiller du salarié ayant assisté le salarié pendant l’entretien préalable est recevable (Cass. soc., 27-3-01, n°98-44666). Il appartient au juge du fond d’en apprécier la valeur et la portée.
2. Le recours à l’inspection du travail
Il peut être utile de recourir à l’inspection du travail dans sa recherche de preuve.
L’inspection du travail dispose d’un droit d’enquête (art. L 8112-5 et L 8113-1 du code du travail).
Les rapports d’enquête peuvent parfaitement être produits, peu important qu’ils n’aient pas été suivis d’un procès-verbal relevant l’infraction (Cass. soc., 15-1-14, n°12-27261).
3. Le recours au juge
Il s’agit ici de s’interroger sur les « outils procéduraux » à disposition du salarié.
a - Formuler une demande de production d’un document
La demande de production de documents peut être formulée devant le juge conciliateur afin qu’il en ordonne la production s’il s’agit de pièces que l’employeur est tenu légalement de délivrer (art. R 1454-14 1° du code du travail).
Par ailleurs, il ressort dudit article (art. R 1454-14 4° du code du travail) que le juge conciliateur peut ordonner des mesures d’instruction. Bien qu’une incertitude semble demeurer sur le sujet, il pourrait être argué de cet article pour tenter d’obtenir un document que l’employeur n’est pas légalement tenu de délivrer (Cass. soc., 7-6-95, n° 91-42604).
La loi Macron du 6 août 2015 a renforcé la mise en état. Cette mise en état est, en principe, assurée par le bureau d’orientation et de conciliation (art. L 1454-1-2 du code du travail).
Une demande de production de documents peut également être formulée devant le juge de la mise en état. En effet, le juge de la mise en état peut mettre les parties en demeure de produire tous documents (art. R 1454-4 et R 1454-2 du code du travail).
En cas de refus opposé au conseiller rapporteur, l’affaire sera, pour autant, renvoyée devant le bureau de jugement. Il appartiendra alors au juge, de tirer toutes les conséquences de ce refus (art. R 1454-4 et R 1454-2 du code de travail).
b - Les mesures d’instruction in futurum
Pour obtenir la production forcée d’une pièce, mais également pour se prévaloir d’un risque de destruction de celle-ci, il peut être recouru, avant tout procès, à une procédure spécifique édictée par l’article 145 du code de procédure civile. Cette procédure doit être diligentée antérieurement à la saisine du contentieux portant sur le fond de l’affaire, au greffe du conseil de prud’hommes.
- Il ressort de cet article que :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La grande différence entre la saisine sur requête ou en référé est que la requête n’est pas contradictoire (et donc permet de se prémunir contre le risque de disparition des preuves), alors que le référé l’est (art. 493 du code de procédure civile).
L’autre différence est que le prononcé d’une ordonnance sur requête nécessite de saisir le président du TGI (Cass. soc., 12-4-95, n°93-10982). En conséquence, l’assistance par un avocat est obligatoire. Le référé in futurum est diligenté devant le conseil de prud’hommes, ce dernier disposant d’une formation de référé.
A noter que l’employeur ne peut arguer du secret des affaires et du respect de la vie personnelle pour faire obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile. La Cour de cassation a jugé que le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées (Cass. soc., 19-12-12, n°10-20526 et 10-20528).
Force est de constater que la preuve du salarié devant le juge prud’homal connaît de nombreux soubresauts, notamment en raison des politiques jurisprudentielles (protéger tantôt le salarié, tantôt l’employeur) et de l’évolution des technologies. Nous ne sommes pas non plus à l’abri de surprises législatives, en particulier à l’occasion de la publication des futures ordonnances réformant le droit du travail.
- L’affaire est donc à suivre…

SECTEUR JURIDIQUE
Note
[1] - InFOjuris n°95, « Vers un anéantissement des présomptions de préjudice en droit du travail ? »
[2] - Notamment la directive n°97-80 du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe. Celle-ci a été complétée, par la suite par deux directives relatives à l’égalité de traitement (Directive n°2000-78 du 27 novembre 2000 et directive n°2000-43 du 29 juin 2000).
[3] - InFOjuris n°88 (déc. 2014/fev2015), « Quand le droit négocié fait présumer l’égalité de traitement… ».
[4] - CPH Grenoble, sect. Act. Div. dép., 5 juill. 2013 (D. Boulmier, Dr. ouvrier 2014, p. 229).
[5] - F.DUQUESNE, « Nouvelles avancées des droits de la défense du salarié menacé de licenciement », Droit social, 2004, p. 938.

![]() Blog publication, 27 février 2020, 16H32
Blog publication, 27 février 2020, 16H32

commenter cet article …

/image%2F0553569%2F20200430%2Fob_354140_l-e-glantine-rouge.jpg)
/image%2F0902201%2F20191023%2Fob_8643c0_retraite.jpg)