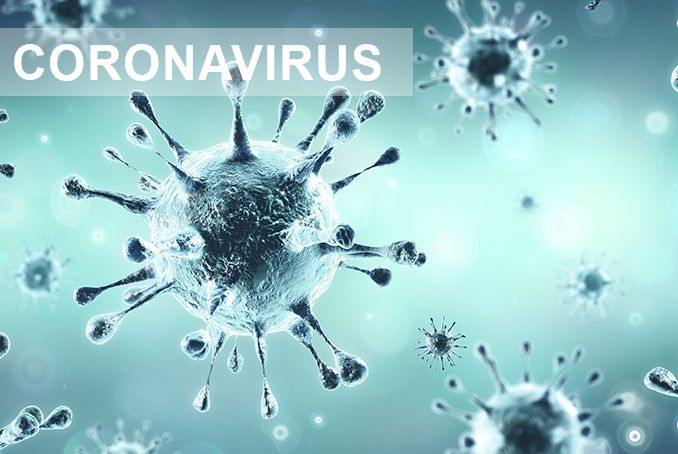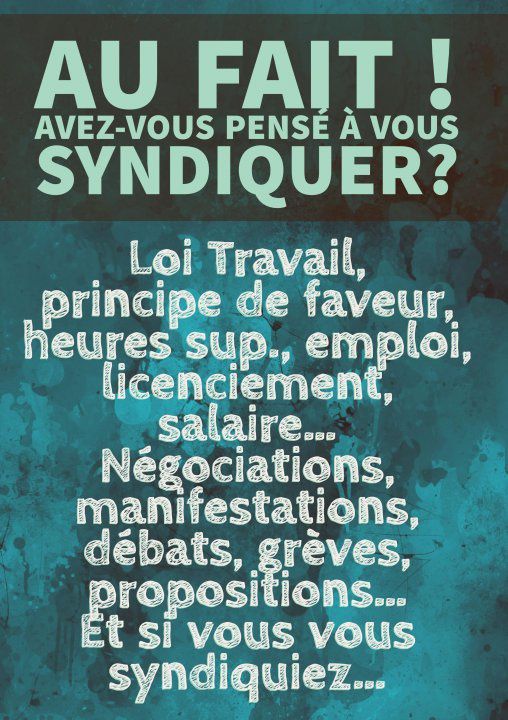JurInFO / Société / Allocations chômage / Chômage partiel / Coronavirus - Covid19 / Emploi / Indemnisation / Santé / Code du travail / Négociations / Branche & secteurs d'activités / IRP / Syndicat / CCN
CORONAVIRUS / LOI D’URGENCE SANITAIRE

Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19
FO vigilante
- La loi instaurant l’état d’urgence sanitaire a finalement été adoptée dimanche 22 mars suite à l’accord trouvé en commission mixte paritaire réunissant sept députés et sept sénateurs.
- Aucun recours devant le Conseil constitutionnel n’ayant été déposé, la loi est promulguée lundi 23 pour une entrée en vigueur immédiate. Elle renvoie à plusieurs ordonnances qui devraient être publiées dans les tous les prochains jours.
Il semble important pour FO, qui a fait part de sa première analyse dès jeudi 19 mars, de rappeler les principales dispositions de la loi, notamment en ce qui concerne le droit du travail et la négociation collective et à souligner les modifications qui ont été apportées par la procédure parlementaire.
- Elections municipales
Le titre 1er de la loi a trait au report du deuxième tour des élections municipales et donne pouvoir au gouvernement de prendre par ordonnance toute mesure permettant d’adapter le droit électoral pour le second tour.
- L’état d’urgence sanitaire
L’état d’urgence sanitaire, créé par l’article 5, peut être déclaré pour une durée d’un mois. Il peut s’appliquer sur tout ou partie du territoire, en métropole et dans les outre-mer. S’il était est appelé à durer plus de 1 mois, la loi reprend la main mais redonne le pouvoir au décret pour le proroger. Durant cette période, le gouvernement doit informer sans délai les 2 assemblées parlementaires de toutes les mesures prises.
Il peut également y être mis fin plus tôt, par décret. Mais par dérogation (article 5 bis), l’état d’urgence sanitaire est décidé pour une période de deux mois, à compter de la publication de la loi.
Les parlementaires ont ajouté un alinéa à cet article pour préciser que « Les mesures prises en application du présent chapitre cessent d’avoir effet en même temps que prend fin l’état d’urgence sanitaire ». Ainsi, les dispositions prises en raison de l’état d’urgence ne peuvent pas perdurer.
L’état d’urgence sanitaire donne tous pouvoirs au Premier ministre en matière de restrictions des libertés fondamentales, aux seules fins de garantir la santé publique.
Par rapport au projet de loi initial, les restrictions sont plus nombreuses mais mieux encadrées :
• restreindre la liberté de circulation dans des lieux et heures fixées par décret ;
• interdiction de sortir du domicile sauf dérogations ;
• mise en confinement des personnes infectées ou susceptibles de l’être ;
• ordonner la fermeture de lieux, sauf les établissements fournissant des biens ou services de première nécessité ;
• limitation ou interdiction de lieux de réunions ou de rassemblements ;
• réquisition de tout bien ou service nécessaires à cette lutte et de toute personne ;
• contrôle des prix de certains produits ;
• en tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire.
La mesure de réquisition de tous biens et services pour lutter contre la catastrophe sanitaire est nécessaire dans le contexte actuel, mais doit interroger les capacités du système hospitalier à faire face à « la catastrophe sanitaire » ainsi que les pénuries de certains produits essentiels. A ce sujet, quelques cas (ce n’est pas une généralité) d’hôpitaux privés ne se mettant pas à disposition sont à noter.
La mesure interroge également les capacités d’anticipations et de préparation du système hospitalier à l’avenir ainsi que la constitution de stocks stratégiques.
La possibilité de réquisition ne doit pas être un substitut à l’anticipation et aux moyens additionnels massifs dont nécessite l’hôpital depuis de nombreuses années.
Sur les mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits, là encore, ce contrôle est nécessaire, notamment en matière de soins et d’alimentation. A cela devrait s’ajouter une réflexion plus large sur la localisation des sites de production, le prix de certains médicaments et l’accès plus général aux soins en temps normal.
La loi prévoit que les mesures prises doivent être proportionnelles aux risques sanitaires encourues et proportionnées aux circonstances de temps et de lieu.
- Amendes et sanctions
Concernant les sanctions en cas d’infractions, les peines ont été alourdies. Toute violation des interdictions ou obligations est punie d’une amende de 135 euros. En cas de récidive dans un délai de quinze jours, la contravention peut aller de 1 500 à 3 000 euros. Si les violations se répètent à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général.
- Jour de carence
L’article 6ter supprime le délai de carence des arrêts maladie tant pour les salariés que les fonctionnaires à compter de la date de publication de la loi, jusqu’à la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.
- Suppressions d’articles
L’article 8 initial prévoyant qu’en cas de démission du gouvernement ou de dissolution de l’assemblée nationale, la loi déclarant l’état d’urgence sanitaire devient caduque, est supprimé, comme l’article 13 qui donnait les pleins pouvoirs au Préfet « en cas de danger ponctuel imminent pour la santé publique ».
- Titre III : les mesures d’urgence économiques
L’objectif est de donner les pleins pouvoirs au gouvernement afin de prendre diverses mesures par ordonnances, dans un délai de 3 mois à compter de la publication de cette loi, au besoin avec effet rétroactif au 12 mars (bien qu’il ne soit pas sûr que cela soit constitutionnel !).
Toutes les modifications qu’apporteront les projets d’ordonnances traitant du droit du travail (article 7 du projet de loi) ne sont pas strictement limitées dans le temps, contrairement aux dispositions limitant les libertés.
Ces mesures qui touchent au Code du travail et de la Sécurité sociale, et désormais au droit de la Fonction publique, visent à « prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi ».
- Ces dernières dispositions se décomposent comme suit :
• limiter les ruptures de contrats de travail en développant le recours à l’activité partielle (nouvelles catégories de bénéficiaires, réduction du reste à charge pour les employeurs (donc augmentation de la prise de la perte de revenu pour les salariés ?), développer la formation professionnelle (par internet puisque confinement ?), une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel (puisqu’il semble qu’il y ait quelques difficultés avec l’activité partielle).
Il n’est pas prévu d’interdire les licenciements (économiques ou non) durant la période de crise sanitaire mais de limiter de tels licenciements en facilitant le recours à l’activité partielle.
Il n’est pas clairement stipulé que l’employeur ne peut recourir à l’activité partielle que si, au préalable, il a tenté de mettre en place du télétravail, mais il semble que les Direccte adoptent cette position sur directive du ministère du Travail.
Si l’on peut se féliciter du recours étendu à l’activité partielle qui permet effectivement de limiter les ruptures de contrats, le dispositif d’activité partielle ne permet toutefois pas une prise en charge à 100% du salaire net. Le coût du dispositif est cofinancé entre l’Unédic (2,75Mds€) et l’État (5,5Mds€).
Cela ne doit pas conduire pas à demander des économies à l’Unédic à l’avenir (d’autant que les dépenses de l’Unédic augmenteront certainement après l’épidémie). FO avait appelé à ce que la prise en charge soit faite par l’État.
• Adapter l’indemnité complémentaire de l’article L 1226-1 du code du travail : il s’agit de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en cas de maladie.
L’ordonnance à venir donnera des précisions.
Pour FO, le fait de prévoir une modification des règles de l’indemnité complémentaire dès lors qu’il est prévu d’élargir le versement de cette indemnité ne peut qu’être encouragé. Il pourrait s’agir de diminuer l’ancienneté minimale du salarié (qui est actuellement d’un an) pour en bénéficier ou l’appliquer aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires qui pour l’instant n’en bénéficient pas.
• Modifier les dates de prise de congés payés et de JRTT (ainsi que les jours de repos prévus par les conventions de forfait) voire utiliser le compte épargne temps. Ces mesures concernent toutes les entreprises (et pas seulement celles nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale).
Il pourrait s’agir d’utiliser tous ces dispositifs avant de permettre le recours à l’activité partielle (et ainsi réduire indirectement le coût pour l’État du chômage partiel).
La loi limite finalement la possibilité pour les employeurs d’imposer les CP à 6 jours (vraisemblablement pour être en conformité avec le droit européen), et seulement par accord collectif d’entreprise ou de branche.
Toutefois, la question demeure de la possibilité de mettre en place de telles négociations dans la mesure où les entreprises sont actuellement fermées (ou en télétravail). Il y a fort à parier que les interlocuteurs sociaux ne puissent pas négocier au niveau de la branche (en raison des délais restreints) même si politiquement l’ouverture d’une négociation au niveau de la branche est importante pour FO.
Des interrogations demeurent pour les petites entreprises : l’employeur pourra-t-il faire appel au référendum ? Encore une fois, en l’absence de salariés dans l’entreprise, l’organisation d’un référendum semble difficile. En effet, la consultation électronique n’est pas prévue par les textes et l’employeur doit respecter un délai minimum de 15 jours entre la transmission du projet d’accord et la consultation (art. L. 2232-21 et R. 2232-10 et suivants).
Par contre, l’employeur pourra imposer ou modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié. Ces dispositions s’appliquent également aux fonctionnaires.
• Dérogation au repos hebdomadaire et dominical, à la durée légale du travail pour les secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale. Les secteurs ne sont pas encore complètement précisés.
Là encore, il faudra rester « dans les clous » du droit de l’union européenne sauf si l’UE elle-même prévoit des dérogations exceptionnelles. FO restera vigilante sur les contreparties salariales pour les salariés mobilisés.
A tout le moins, cette dérogation de droit aux règles sur la durée du travail, le repos hebdomadaire ou le repos dominical, devrait comprendre expressément une limite (en heures et durée), et faire en sorte que le repos compensateur soit accordé immédiatement après la période de travail dans un souci de préservation de la santé et la sécurité des salariés, le calcul de la semaine devant se faire sur une période de 7 jours consécutifs (ne pas faire référence au droit de l’Union qui permet de travailler 12 jours consécutifs avant d’avoir un repos). Il conviendra également de prévoir une augmentation des temps de pause.
Le travail de nuit ne semble pas visé. La question du droit à des majorations pour heures supplémentaires devra être éclaircie. Le cas spécifique des salariés sous forfaits jours devra aussi être abordé.
Tout au long de l’examen de ce texte, FO a mis en garde contre le risque d’ajouter des dangers sur la santé et la sécurité au travail, due à des intensités et durées de travail plus longues, à celui du coronavirus. Ce serait in fine contreproductif par rapport à l’objectif affiché ! Pour FO, il vaut mieux alléger les conditions de travail (restrictions des horaires d’ouvertures, renforcement des équipes tournantes en recrutant là où c’est possible aisément, en assurant des conditions de travail saines et sûres vis-à-vis du risque épidémique) ;
• La loi ouvre la possibilité de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation.
Conformément aux délais légaux qui les encadrent, les sommes issues de la participation et de l’intéressement doivent être versées avant le 1er jour du 6e mois suivant la clôture de l’exercice de l’entreprise, sous peine d’un intérêt de retard. Le projet de loi vise donc à modifier ces délais, afin, selon l’exposé des motifs « de permettre aux établissements teneurs de compte de l’épargne de ne pas être pénalisés par les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie ».
FO déplore que seuls les intérêts de ces établissements soient ici pris en compte et revendique qu’un nouveau cas de déblocage anticipé soit créé pour permettre aux salariés de bénéficier des sommes bloquées dans ce contexte exceptionnel.
Le texte prévoit aussi de modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Cette mesure ne figurait pas dans le projet de loi initial. Cet ajout fait suite à plusieurs déclarations gouvernementales appelant les entreprises à verser une prime défiscalisée aux salariés qui ont « eu le courage de se rendre sur leur lieu de travail » malgré les risques encourus.
FO a indiqué publiquement que cette mesure ne peut en aucun cas inciter les salariés à s’affranchir des meilleures conditions de sécurité et de santé. Il n’est pas question de remplacer une insuffisance en matière de sécurité et de santé par une prime.
De plus, ce mécanisme accroit les inégalités entre les salariés contraints de se rendre sur leur lieu de travail. En effet, si les salariés des grands groupes, en tout ou partie, pourront, au bon vouloir de leur employeur, en bénéficier, les plus petites entreprises ne disposeront à l’évidence pas de la trésorerie suffisante pour mettre en place ce dispositif.
Force est de constater également l’absence d’un tel dispositif pour les agents publics qui se voient contraints de poursuivre leur mission de service public en se rendant sur leur lieu de travail.
En revanche, reconsidérer beaucoup des métiers dont on découvre qu’ils sont essentiels pour les rémunérer beaucoup mieux qu’ils ne le sont aujourd’hui et de façon pérenne aurait beaucoup plus de sens.
• L’alinéa 8 de l’article 7 porte sur les élections TPE. Le texte prévoit "d’adapter l’organisation de l’élection mentionnée à l’article L. 2122-10-1 du code du travail, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral".
Cette précision laisse entendre que le gouvernement va bien envisager de reporter la date des élections. En effet, selon l’article L 2122-10-2, « sont électeurs les salariés des entreprises qui emploient moins de onze salariés au 31 décembre de l’année précédant le scrutin ».
Par conséquent, si le scrutin est reporté à l’année prochaine, il sera nécessaire de modifier la date d’appréciation des conditions d’électorat.
A titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles pourra donc être prorogée.
• Services de santé : aménagement de la surveillance médicale par les SST en raison de l’épidémie.
Sur ce point, Force ouvrière revendique la mise en place d’un suivi médical renforcé via les services de santé au travail pour tous les travailleurs exposés quotidiennement au COVID-19.
En outre, FO s’interroge sur la nécessité de légiférer par ordonnance sur le FIVA (Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante) et non le seul ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux) : l’indemnisation des victimes du covid-19 ne doit en aucun cas pénaliser l’indemnisation des victimes d’autres situations ou catastrophes sanitaires.
• Consultation des CSE, alinéa 10. Il est simplement prévu « de modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du Comité social et économique, pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis ».
Aucune précision n’est apportée. Il est impossible de savoir sur quoi vont porter ces modalités. Il pourrait s’agir de rendre possible la généralisation de la visioconférence, à l’initiative de l’employeur. Il n’est apparemment pas prévu de prolonger les délais puisque le texte fait référence aux "délais impartis".
Pour FO, il faudrait, a minima, que ces aménagements ne s’appliquent qu’aux consultations rendues absolument nécessaires en cette période de crise sanitaire, en particulier s’agissant des questions de santé et qu’une suspension des autres consultations soit imposée. Se pose également la question des moyens mis en œuvre pour faciliter ces consultations et leur efficacité.
Ce même alinéa apporte une précision qui concerne les élections des CSE en cours puisqu’il est prévu que ces dernières soient suspendues. On peut aisément comprendre cette mesure.
Toutefois, se pose la question de la représentation du personnel dans les entreprises concernées, sachant que la plupart des entreprises organisant leurs élections actuellement sont celles qui n’avaient pas procédé à la mise en place du CSE au 1er janvier 2020. Or, FO avait demandé, et cela s’avère aujourd’hui d’autant plus pertinent, que dans ces entreprises aient pu être prorogés les mandats des anciens élus CE. Ces entreprises et leurs salariés vont donc se retrouver sans aucun représentant du personnel.
Sur un plan plus pratique, la suspension de toutes les élections pose également la question d’une éventuelle prolongation du cycle de représentativité en cours, puisque certains résultats risquent de ne pas être comptabilisés à temps. La même remarque peut être faite, s’agissant des élections TPE puisque leur éventuel report aura aussi une incidence sur le calcul de la représentativité dans les délais.
• Assouplissement des factures pour microentreprises (c’est-à-dire moins de 10 salariés et moins de 2 millions de chiffre d’affaires annuel) et non plus les PME comme le stipulait le projet de loi initial, ce qui réduit fortement la portée de la mesure. Les particuliers, les PME de plus de 10 salariés et les grandes entreprises ne sont pas visés.
Pour FO, cette mesure aurait pu s’étendre aux salariés et à leurs logements dont la consommation d’eau, gaz et électricité augmente du fait du confinement.
• Adapter les dispositions relatives à l’organisation de la Banque publique d’investissement afin de renforcer sa capacité à accorder des garanties. Cette mesure concrétise l’annonce d’une garantie à hauteur de 300 Mds€ des prêts contractés par les entreprises. Elle ne pèse pas forcément sur les finances publiques. Il s’agit d’engagements hors bilan – listés en annexe de la loi de règlement - qui peuvent intégrer le déficit et la dette publique uniquement s’il y a défaut de paiement.
- Procédures administratives et judiciaires
Le 2e de cet article vise les procédures administratives et judiciaires, pour les reporter, les interrompre ou en suspendre les délais. Ainsi, les éventuels recours effectués en matière d’élections professionnelles bénéficieraient de délais supplémentaires puisqu’il n’y a plus ou presque plus de juridiction en exercice. Cela ne peut qu’être encouragé le fait de reporter, suspendre, interrompre les délais judiciaires.
- Garde d’enfants
Le 3e de cet article permet aux parents dont l’activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de travail de pouvoir faire garder leurs jeunes enfants. De manière exceptionnelle, l’extension du nombre d’enfants gardés simultanément par une assistante maternelle peut être prévue.
Pour FO, ce choix parait illogique et contraire à la préservation de santé publique. Il fait prendre des risques à l’assistante maternelle et aux personnes vivant dans son foyer. Les accueils collectifs sont davantage adéquats pour accueillir un nombre supplémentaire d’enfants que les pièces d’un appartement (ou maison) où la famille de l’assistante maternelle est confinée également !
Il faudrait privilégier la réquisition des accueils collectifs et la limitation de l’accès aux enfants des personnels tels que médecins, infirmiers, ambulanciers, pharmaciens, personnels de maisons de retraite, puisque d’autres mesures pour garder ses enfants à la maison ont été mises en place pour les autres parents (arrêts maladie, télé travail). Enfin, il faudrait élargir l’accès aux enfants des personnels qui travaillent pour la protection de l’enfance (foyers, centre d’accueils, …)
Le 4e de cet article vise le maintien de l’accompagnement et de la protection des personnes en situation de handicap et des personnes âgées.
Il faudra désormais attendre les ordonnances qui vont suivre. Pour rappel : les lois de ratification de ces ordonnances devront être prises dans un délai de 2 mois.
- La loi précise, que « les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire ».
- En conséquence, en raison de la situation d’urgence, il n’y aura pas de consultation des partenaires sociaux sur les projets d’ordonnance (exit l’article 1 du Code du travail !).

FRÉDÉRIC SOUILLOT
- Secrétaire confédéral au Secteur de l’Organisation, des Outre-Mer et des Affaires juridiques
KAREN GOURNAY
- Secrétaire confédérale au Secteur de la négociation collective et des salaires
MICHEL BEAUGAS
- Secrétaire confédéral au Secteur de l’Emploi et des retraites
NATHALIE HOMAND
- Secrétaire confédérale au Secteur de l’Economie et du Service Public
SERGE LEGAGNOA
- Secrétaire confédéral au Secteur de la Protection Sociale Collective
YVES VEYRIER
- Secrétaire général de Force Ouvrière


![]() Blog publication, 24 mars 2020, 16H09
Blog publication, 24 mars 2020, 16H09

commenter cet article …

/image%2F0553569%2F20200430%2Fob_354140_l-e-glantine-rouge.jpg)
/image%2F0902201%2F20191023%2Fob_8643c0_retraite.jpg)